Notre histoire en archives : L'incendie de l'hôtel
Continental (1943)
Marc-André Moreau, technicien en documentation à
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
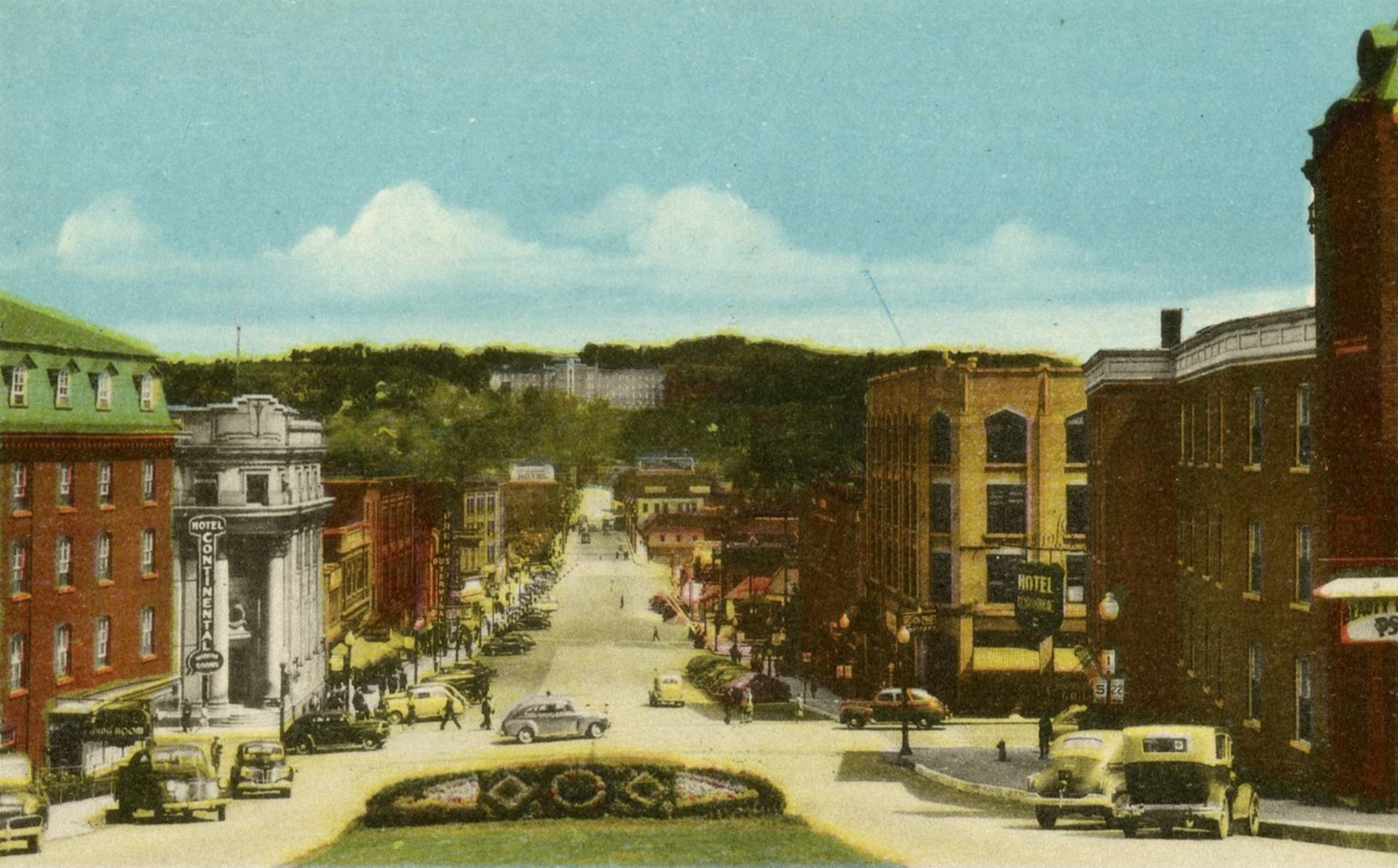
Intersection des rues King et Wellington. L'édifice de
brique au toit mansardé ainsi que l'enseigne de l'Hôtel Continental sont
visibles à gauche, carte postale, Toronto, Photogelatin Engraving Co. Limited, vers 1935. Archives
nationales à Sherbrooke, collection Freeman Clowery (P14, S71, P152). Photographe
non identifié.
Construit en 1872 par Henri Camirand, hôtelier issu d'une
des plus anciennes familles francophones établies à Sherbrooke, l'Hôtel
Continental est, pendant plus de 70 ans, un des établissements les plus
emblématiques du centre-ville de Sherbrooke. Lieu de rencontre de prédilection
pour de nombreux hommes d'affaires, l'établissement est aussi prisé par les
clubs sportifs et par des associations politiques, en particulier celles
d'allégeance conservatrice.
L'emplacement de cet hôtel au carrefour des rues King et
Wellington, lequel fut parfois nommé Continental Square, lui assure une grande
visibilité ainsi qu'un afflux de clientèle. Située à proximité de la gare du
Grand Tronc et de nombreux commerces, cette intersection devient encore plus
achalandée lorsque, en 1930, elle est désignée comme point de correspondance
des autobus de la ville.
Nombreux sont ceux qui fréquentent cet hôtel ainsi que son
restaurant et sa taverne, jusqu'à ce qu'en novembre 1943, une tragédie vienne
abruptement mettre fin à son ère de gloire.
Un incendie soudain,
une évacuation ordonnée

Charles E. Goad, Plan d'assurance-incendie de la ville de
Sherbrooke, extrait de la planche 16 permettant de situer l'Hôtel Continental à
l'angle supérieur gauche des rues King et Wellington, 1917.
Dans la nuit du 10 novembre, un incendie de cause inconnue
débute dans la chambre des fournaises de l'hôtel. Vers 1 h 30, le concierge de
nuit, installé à la réception, perçoit une odeur de fumée dans l'hôtel et
active l'alarme d'incendie. Il contacte aussitôt le Département de la police et
du feu, puis frappe aux portes des chambres de l'hôtel afin d'alerter leurs
occupants.
Grâce à ces initiatives, la majorité des résidents parviennent
à quitter l'hôtel sans être affectés par l'incendie. Plusieurs d'entre eux,
cependant, ne sont vêtus que de leur tenue de nuit et, en cette froide nuit de
novembre, trouvent refuge à l'Hôtel Normandie situé en face. L'évacuation, bien
que réalisée en toute hâte, s'est déroulée de façon ordonnée et, parmi les
clients de l'hôtel, un seul manque à l'appel...
Une lutte acharnée

Incendie à l'Hôtel Continental, 10 novembre 1943. Une
échelle est appuyée sur Kushner's, le commerce voisin. Archives nationales à
Sherbrooke, fonds Jacques Darche (P5, S1, SS3, D1, P221). Photo : Jacques
Darche.
À leur arrivée, les policiers-pompiers constatent que les
flammes ont déjà envahi le deuxième étage du bâtiment. Une vingtaine d'entre
eux sont déployés et tentent de maîtriser le feu à l'aide de six boyaux
d'incendie. Cependant, étant donné l'ampleur du sinistre, leurs efforts
s'avèrent insuffisants et, au cours de l'heure suivante, les flammes se
propagent aux autres étages.
Face à cette situation critique, Percy Donahue, le directeur
du Département de la police et du feu, décide de doubler les effectifs sur
place et de leur octroyer toutes les ressources disponibles. Cette fois également, en dépit de leurs
efforts, les policiers-pompiers voient le feu s'intensifier et parvenir à
transpercer le toit du bâtiment. Pour tenter de limiter sa propagation,
certains d'entre eux arrosent l'incendie à partir des toits des bâtiments
voisins. Ce travail est cependant ardu et la fumée dense les repousse maintes
fois.
Les policiers-pompiers mènent une lutte acharnée contre
l'incendie et, à plusieurs reprises, lorsque les flammes paraissent
s'amenuiser, elles redoublent subitement d'intensité. Ce n'est qu'un peu avant
six heures du matin, après environ quatre heures de lutte, que le feu est
finalement éteint.
L'incendie de l'Hôtel Continental aura été éprouvant pour le
Département de police et du feu de Sherbrooke qui le compare, par son ampleur,
à celui de l'Hôtel Grand Central survenu cinq ans plus tôt. La qualité de
l'équipement des policiers-pompiers, notamment l'utilisation de pompes modernes
et performantes, ainsi que la mise en place d'un nouveau circuit de boîtes
d'alarme incendie, auront cependant permis d'éviter des pertes humaines.
Quelques jours seulement avant l'éclatement de l'incendie, les 17 boîtes
d'alarmes situées sur les rues Wellington, King et Frontenac, vieilles d'une
cinquantaine d'années, avaient été remplacées par de nouvelles boîtes d'alarmes
plus efficaces.
L'incendie de l'Hôtel Continental cause des dommages
considérables estimés entre 70 000 et 75 000 $ (soit environ 1,2 à 1,3 million
de dollars en valeur actuelle). Deux policiers-pompiers ont subi des blessures
mineures mais, heureusement, aucune personne n'est hospitalisée. Quant au
client de l'hôtel qui n'était pas parvenu à quitter les lieux initialement, il
est finalement secouru à temps par les pompiers : souffrant de surdité, il
n'aurait pas entendu l'alarme ni l'alerte donnée par le concierge...
Un centre-ville
transformé

Édifice Continental, à l'intersection des rues King et
Wellington à Sherbrooke, 10 ans après l'incendie de l'Hôtel Continental, 1953.
Archives nationales à Sherbrooke, fonds Studio Boudrias (P21, S1, D2, P44).
Photo : Studio Boudrias.
L'incendie aura détruit l'un des bâtiments commerciaux les
plus achalandés de la ville de Sherbrooke. Pendant près de quatre années, les
ruines de l'Hôtel Continental rappellent inévitablement cette tragédie à tous
ceux qui fréquentent le centre-ville sherbrookois. Plusieurs rumeurs circulent
quant à l'avenir de l'hôtel : sera-t-il reconstruit ou non?
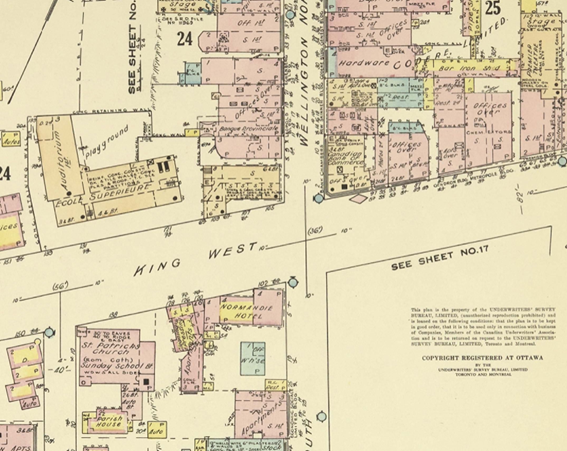
Plan d'assurance-incendie de la ville de Sherbrooke, extrait
de la planche 16 permettant de situer l'édifice Continental à l'intersection
des rues King et Wellington, Toronto, Underwriters' Survey Bureau Limited,
1953.
En 1947, l'industriel sherbrookois Léopold Chevalier ainsi
que plusieurs associés en font l'acquisition pour le prix de 55 000 $ (un
montant équivalant à un peu plus de 823 000 $ aujourd'hui). Dès l'année
suivante, il fait construire à l'emplacement de l'ancien hôtel un imposant
édifice recouvert de granite de Scotstown afin d'y louer des locaux à des
commerçants et des professionnels.

Édifice Continental, au coin des rues King et Wellington à
Sherbrooke, 1960. Archives nationales à Sherbrooke, fonds Studio Boudrias (P21,
S2, D211, P1). Photo : Studio Boudrias.
Malgré son esthétique remarquablement moderne, cet édifice
porte en lui l'héritage de son prédécesseur. Son nom, l'Édifice Continental,
rend ouvertement hommage à l'hôtel qui s'y trouvait auparavant. Surtout, le
nouveau bâtiment a été construit sur les fondations renforcées de l'ancien
hôtel, dont les murs droits et arrières ont été préservés afin d'être intégrés
dans la construction de la nouvelle structure.
À l'abri du regard de tous et à l'insu de plusieurs, une
part de l'Hôtel Continental subsisterait donc en plein cœur de la ville de
Sherbrooke.
Pour obtenir plus d'informations sur l'histoire d'événements
qui, comme ces incendies, ont marqué l'histoire de l'Estrie, nous vous invitons
à venir consulter les fonds et collections sur la région conservés par
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) :
Archives nationales à Sherbrooke
225, rue Frontenac, bureau 401
819 820-3010, poste 6330
archives.sherbrooke@banq.qc.ca
Sources :
« 39 guests
escape from burning hotel », Sherbrooke Daily Record, 10 novembre 1943, p. 2-3.
« Installation de boîtes d'alarme », La Tribune, 30 octobre
1943, p. 5.
« Modern
business block replaces old Continental Hotel », Sherbrooke Daily Record, 21
décembre 1948, p. 2.
« Remains
of late Mrs. Camirand laid to rest », Sherbrooke Daily Record, 6 mars 1919, p.
7.
« Équipement qui a été bien précieux », La Tribune, 12
novembre 1943, p. 3 et 8.
« L'Hôtel Continental ravagé par le feu », La Tribune, 10
novembre 1943, p. 3.
« Le Continental à vendre à quiconque bâtira un vaste
édifice commercial », La Tribune, 28 décembre 1946, p. 3.
« Transaction finale le 11 octobre 1947 », La Tribune, 31
décembre 1948, p. 16.
« Une heureuse transaction », La Tribune, 18 octobre 1947,
p. 4.
KESTEMAN, Jean-Pierre, Guide historique du vieux Sherbrooke,
Sherbrooke, Société d'histoire de Sherbrooke, 2001, 2e éd., 1985, 271 p.