Notre histoire en archives : L'âge d'or de la fourrure
Par Mathilde Loubier, stagiaire à Bibliothèque et Archives
nationales du Québec

La chasse étant l'une des principales activités économiques
du XVIIe au XIXe siècle, la fourrure s'est imposée comme un élément
incontournable de la mode au Québec. Appréciée par tous, elle est prisée autant
pour sa chaleur que pour sa durabilité. Les gens se couvrent de peau de mouton,
de bison, de coyote, de castor, de renard, de phoque ou encore de caribou :
les ressources semblent alors inépuisables.
À la fin du XIXe siècle, la fourrure ne se limite plus à un
simple vêtement fonctionnel : elle devient un symbole de
prestige, de raffinement et de luxe. Son usage s'étend des manteaux aux
accessoires comme les chapeaux, les gants, les manchons et les bordures de
capes.
Cette évolution marque le passage d'une économie basée sur
la traite des fourrures à une véritable industrie de la mode, où le travail des
pelleteries se raffine et s'adapte aux tendances et aux exigences d'une
clientèle toujours plus sophistiquée.
Du commerce des fourrures à l'industrie de la mode
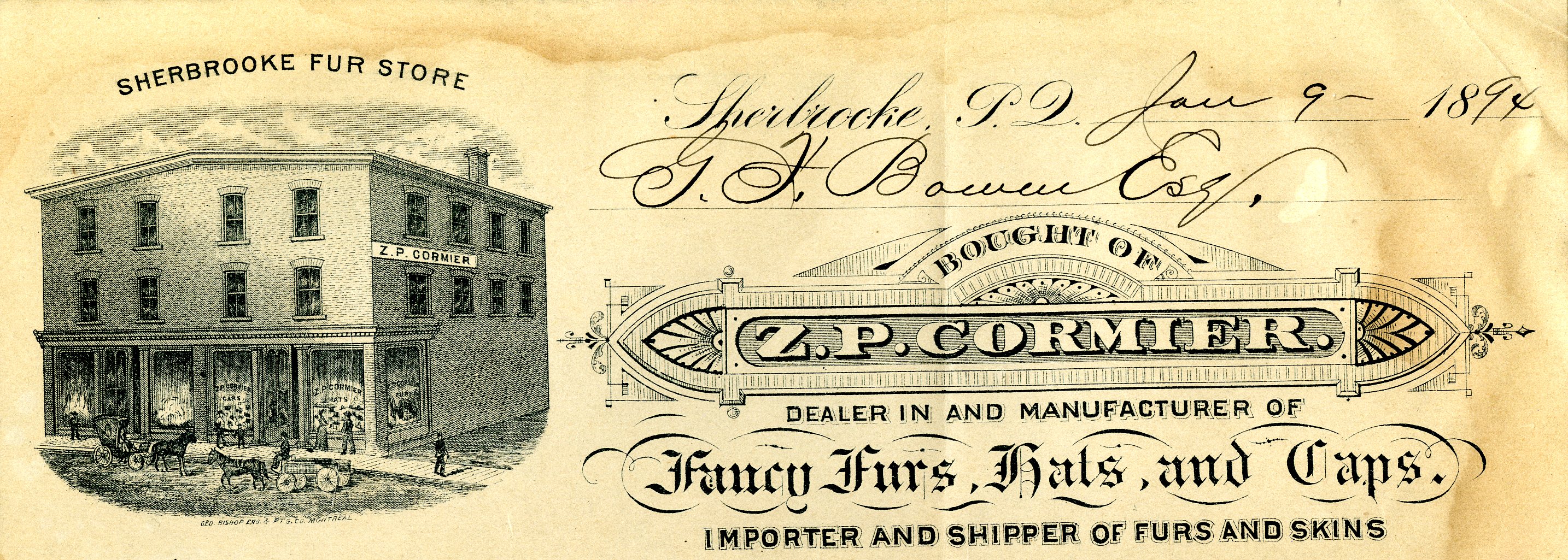
En-tête d'une facture du magasin Z. P. Cormier, commerçant
de fourrure à Sherbrooke, 1894. Archives nationales à Sherbrooke, fonds Famille
Bowen (P4, S2, SS1, D1).
Dès le début du XVIIe siècle, les colons français
établissent des comptoirs de traite
de fourrure le long du fleuve Saint-Laurent et dans la région des Grands
Lacs. S'alliant avec des communautés autochtones comme les Algonquins, ils
développent un commerce florissant qui devient rapidement l'un des piliers
économiques de la Nouvelle-France.
Ce commerce est marqué par une forte concurrence, notamment
entre la Compagnie
de la Baie d'Hudson et la Compagnie du Nord-Ouest, qui se disputent les
territoires de capture jusqu'au XIXe siècle. Malgré ces rivalités, l'industrie
continue de prospérer, si bien que Montréal
devient la plaque tournante de la fourrure, abritant plus de la moitié des
fourreurs du pays!
Mode féminine
Sous le
Régime français, les
femmes, qu'elles vivent en ville ou à la campagne, portent
généralement une jupe accompagnée d'une blouse. Leurs dessous se composent
d'une chemise descendant jusqu'aux genoux, d'un corset sans manches s'arrêtant
à la taille et de bas en laine. Afin d'affronter les rigueurs de l'hiver, elles
portent un manteau de laine ou de fourrure, et les chaussures laissent la place
aux bottes ou aux mocassins. Leur habillement se veut pragmatique et adapté au
climat difficile de la colonie.
Aux XIXe et XXe siècles,
le renard roux ou argenté domine la mode avant d'être supplanté par des
fourrures à poil court, comme le mouton de Perse. C'est l'ère des
luxueuses parures de cou et des précieuses martres canadiennes, prisées par les
femmes distinguées. Certaines étoles arborent même la tête de l'animal, un gage
de prestige supplémentaire qui fait grimper leur valeur marchande.
Avec la Seconde Guerre mondiale, l'entrée des femmes sur le marché du
travail leur permet d'accéder à une plus grande autonomie financière, ce
qui influence leurs habitudes de consommation. La demande pour des vêtements
sophistiqués comme la fourrure s'accroît considérablement.
Voici quelques beaux portraits de femmes arborant des
fourrures :

Graziella Beaulne et ses amies, vers 1895. La femme élégante
de la fin du XIXe siècle porte le chapeau à aigrettes, à plumes ou à rubans et
le manteau à col et manchon de fourrure, souvent en mouton de Perse. Sur la
deuxième rangée sont identifiées Maud Bridgitt Mary Paquette (1re) et Graziella
Beaulne (3e), des amies vivant alors toutes deux à Waterloo, dans les
Cantons-de-l'Est. Archives nationales à Sherbrooke, fonds Famille Lippé (P39, S11,
SS2, D1, P3). Photographe non identifié.

Portrait de studio d'une jeune femme inconnue, entre 1909 et
1922. Habillée avec élégance pour une sortie par temps frais, la dame porte un
chapeau à revers, des gants en peau de chevreau et un manteau sur lequel est
posée une étole en fourrure de renard roux avec la tête. Archives nationales à
Sherbrooke, fonds Famille Masson (P1001, S4, D1, P2). Photo : Thompson
Brothers.

Cécile Lauretta Masson, originaire de Danville, 1928. Cécile
porte un manteau à col de fourrure et un chapeau cloche. Archives nationales à
Sherbrooke, fonds Famille Masson (P1001, S3, D5, P2). Photo prise dans une
cabine photographique.

Delphine Bégin et Marie Fortier vêtues de longs manteaux de
fourrure aux cols relevés et de manchons assortis, avant 1941. Archives
nationales à Sherbrooke, fonds Sylvio Lacharité (P3). Photographe non
identifié.

Dame inconnue au manteau et toque de fourrure, vers 1943. Ce
magnifique portrait est capté par un simple photomaton. Le sujet offre, tout à
la fois, un regard de braise et un air inaccessible. Archives nationales à
Sherbrooke, fonds Jacques Darche (P5, S1, SS3, D1, P180). Photo prise dans
une cabine photographique.

Madeleine Bédard, vers 1945. Madeleine Bédard, en manteau
léopard et les mains enfouies dans un sac-manchon, prend la pose, rue Murray,
avec l'arrière de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul comme arrière-plan. Archives
nationales à Sherbrooke, fonds Jacques Darche (P5, S1, SS3, D1, P242).
Photographe non identifié.
Mode masculine
Jusqu'en
1900, les manteaux en loutre ou en castor sont en vogue dans les milieux
urbains, où ils symbolisent la réussite sociale. Les hommes adoptent également
le rat musqué, parfois rasé ou teint, ainsi que le chat
sauvage.
Après
1900, les manteaux de fourrure continuent d'être populaires, mais la mode
évolue et les types de fourrures changent. Bien que les fourrures de castor et
de loutre restent associées à la réussite sociale, d'autres fourrures comme le
vison, le renard et la martre gagnent en popularité. Certains possèdent de longs
manteaux épais, inspirés de l'aristocratie européenne, une tendance qui finit
par gagner aussi la mode féminine.
Souvent lourd à porter, le manteau de fourrure est
particulièrement apprécié pour son incroyable capacité à conserver
la chaleur, permettant de braver les rigoureux hivers québécois. Au manteau
s'ajoutent souvent les mitaines et les chapeaux de fourrure, avec ou sans la
queue ou la tête de l'animal.

Homme inconnu portant un manteau décoré de fourrure au
niveau du collet et des manches, vers 1896. Archives nationales à Sherbrooke,
fonds Famille Lippé (P39). Photo : E. A. Poulin.
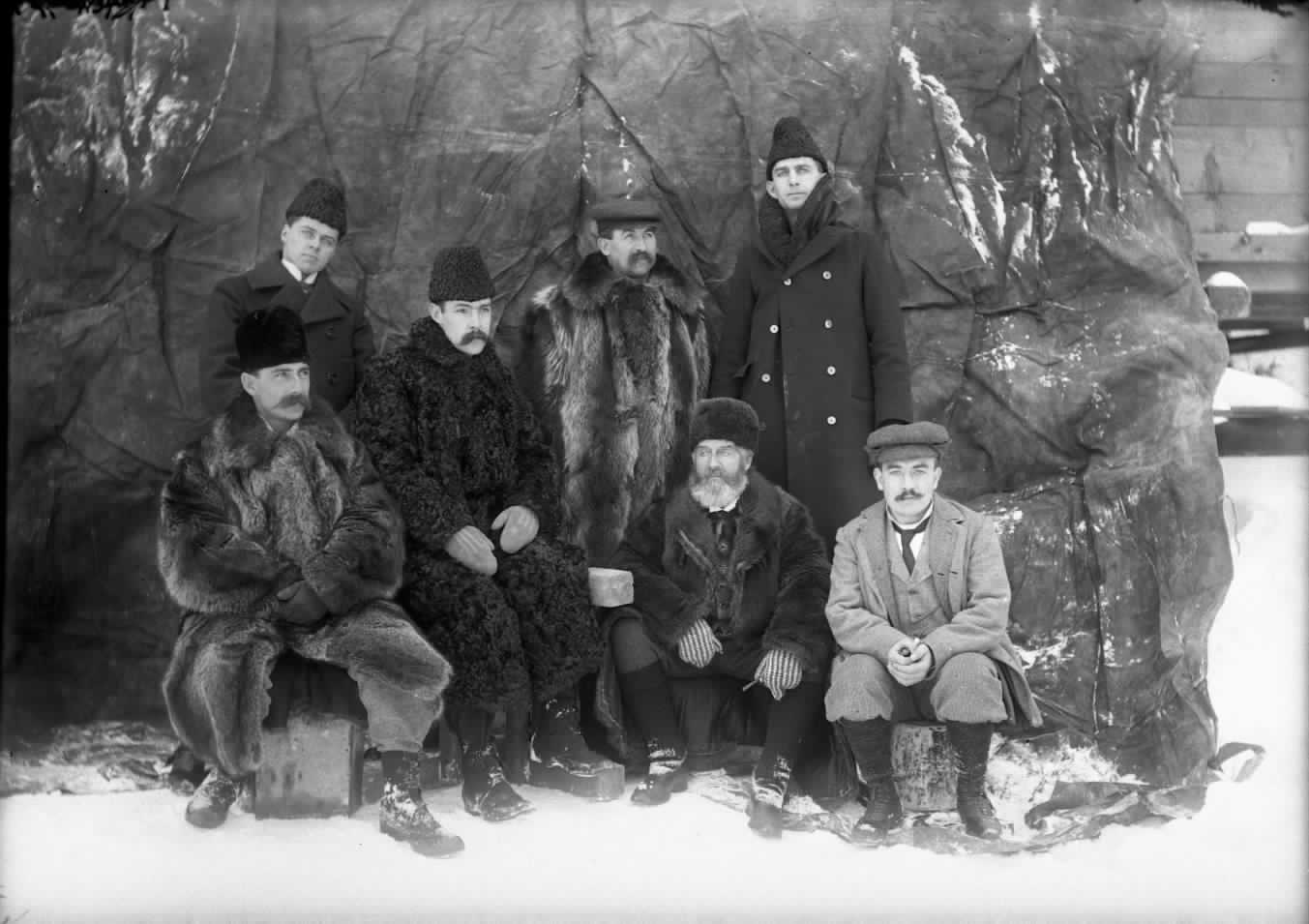
Sept hommes profitent de l'hiver, vêtus de manteaux et de
chapeaux en fourrure, vers 1897. Archives nationales à Sherbrooke, fonds
Johns-Manville Canada Inc. (P56, S1, SS1, D1, P521). Photographe non identifié.
Mode junior
Les
enfants portent généralement des vêtements similaires à ceux de leurs
parents, souvent confectionnés à partir des chutes de tissus utilisés pour
leurs habits. Il n'est pas rare de voir les enfants d'une même famille vêtus de
la même manière, surtout le dimanche et lors des fêtes. Les manteaux en
fourrure conçus pour les plus jeunes allient praticité et esthétisme. Ainsi, la
fourrure n'est pas réservée aux adultes.

Irène Lacharité avec manteau rehaussé de fourrure blanche, 1936.
Archives nationales à Sherbrooke, fonds Sylvio Lacharité (P3). Photographe non
identifié.
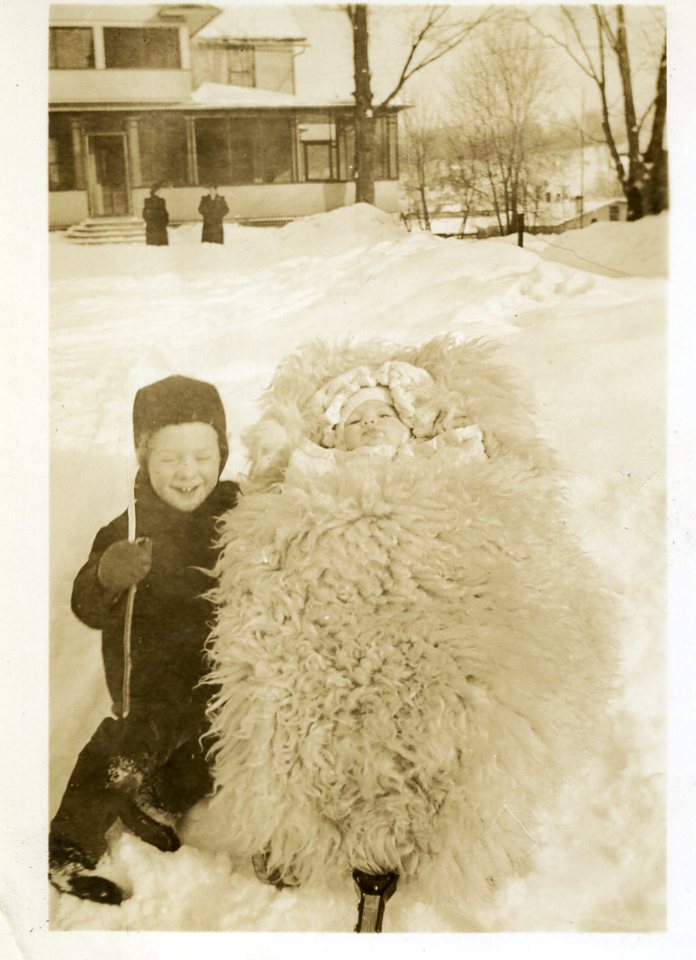
Pierre Lippé et sa petite soeur Francine Lippé couchée et emmaillotée dans une peau de mouton sur un traîneau, 1943. Archives nationales à Sherbrooke, fonds Famille Lippé (P39, S7, SS3, D4). Photographe non identifié.

Le petit Saint-Jean-Baptiste, vers 1945. Le garçon est habillé
d'une laine de mouton pour symboliser Jean le Baptiste, patron des bergers, qui
désigna Jésus comme « l'Agneau de Dieu » dans la tradition chrétienne.
Archives nationales à Sherbrooke, fonds Louis Devost (P65). Photographe non
identifié.
La transformation de l'industrie

Un groupe de gens sur une galerie à Lac-Mégantic, avec de
jolis chapeaux, manteaux et manchons en fourrure, dans les années 1910. Le
dernier à droite dans la deuxième rangée : De Lourdes Lippé. Le dernier à droite
dans la troisième rangée : le vicaire L.-A.-O. Huard. Archives nationales à Sherbrooke,
fonds famille Lippé (P39, S4, SS1, D3, P4). Photographe non identifié.
Comme on le constate, toute la famille porte de la fourrure
et l'apprécie. Toutefois, à partir des années 1980, l'industrie de la fourrure
connaît un déclin
progressif. La prise de conscience
écologique, portée par des campagnes de sensibilisation d'organismes comme
Greenpeace, pousse de nombreux consommateurs à revoir leurs choix.
Parallèlement, les matières
synthétiques gagnent en popularité, perçues comme plus éthiques.
Le boycottage croissant de la fourrure rend son port plus
controversé, mais l'industrie s'adapte. Plutôt que de disparaître, elle se
réinvente à travers le recyclage. Des entreprises spécialisées transforment
désormais les fourrures en coussins, sacs à main, porte-clés, pompons pour
tuques et autres accessoires.
La fourrure demeure un élément important du patrimoine
québécois. Historiquement au cœur du développement économique et des échanges
commerciaux, elle représente un savoir-faire ancestral transmis de génération
en génération. Aujourd'hui, son recyclage permet de préserver cet héritage tout
en répondant aux préoccupations environnementales modernes. Le Québec allie
tradition et innovation, perpétuant ainsi une industrie qui fait partie de son
identité culturelle.
Ces archives vous intéressent? Prenez rendez-vous avec nous
ou venez nous voir!
Archives nationales à Sherbrooke
225, rue Frontenac, bureau 401
819 820-3010, poste 6330
archives.sherbrooke@banq.qc.ca
Sources
BACK, Francis, « Les dessus et les dessous de la mode à
Montréal », Cap-aux-diamants, vol. 32, n° 130, été 2017, p. 15-19, https://www.erudit.org/en/journals/cd/2017-n130-cd03250/86741ac.pdf.
BAIRD, Daniel, « L'habillement à l'époque
coloniale », Encyclopédie canadienne, 16 décembre 2013, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/lhabillement-a-lepoque-coloniale.
BORBOËN, Véronique, « Lecture de la mode et du vêtement
dans le portrait photographique québécois au 19e siècle (1860-1914) », thèse
de doctorat (études pratiques des arts), Université du Québec à Montréal, 2014,
523 p., https://archipel.uqam.ca/10691/1/D2759.pdf.
BOURDAGES, Gaétan, « Le castor de la discorde », La
Société d'histoire de la Prairie-de-la-Magdeleine, 2025, https://shlm.info/articles/le-castor-de-la-discorde/.
DUBUC, Élise et Josée ROBERTSON, « Les Robertson de
Mashteuiatsh », Cap-aux-diamants, vol. 19, n° 76, hiver 2004, p. 26-28, https://www.erudit.org/fr/revues/cd/2004-n76-cd1046045/7302ac.pdf.
FALLU, Jean-Marie, « La tradition vestimentaire »,
Magazine Gaspésie, vol. 53, n° 1 (185), mars-juin 2016, p. 3-11, https://www.erudit.org/fr/revues/mgaspesie/2016-v53-n1-mgaspesie02607/82752ac.
FOOT, Richard, Michelle FILICE, « Traite des fourrures
au Canada », L'encyclopédie canadienne, 1er novembre 2019, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/traite-des-fourrures.
JANDOT, Olivier, « La douce chaleur du poil. Les usages
de la fourrure, entre mode et nécessité XVIe-XVIIIe », Modes pratiques, vol.
2, 2015,
siècleshttps://devisu.inha.fr/modespratiques/398?file=1&utm.
HERSCOVICI, Alan, « La fourrure est-elle encore une
matière chaude même lorsqu'elle est rasée pour être moins encombrante? », Truth
About Fur, 7 mars 2022, https://www.truthaboutfur.com/faq/la-fourrure-est-elle-encore-une-matiere-chaude-meme-lorsquelle-est-rasee-pour-etre-moins-encombrante/?lang=fr#:~:text=Une%20grande%20partie%20de%20la,le%20vent%20et%20la%20pluie.
PROVENCHER, Jean, « Ni or, ni diamant, que de la
fourrure », Cap-aux-diamants, vol. 6, n° 24, hiver 1991, https://www.erudit.org/fr/revues/cd/1991-n24-cd1041843/7755ac.
ROBITAILLE-SAINT-CYR, Françoise, « Une institution à
Québec », Cap-aux-diamants, vol. 19, n° 76, hiver 2004, p. 30-33, https://www.erudit.org/fr/revues/cd/2004-n76-cd1046045/7303ac.pdf.
RUTTLE, Terence, Le classement des fourrures, Ottawa, Ministère
de l'Agriculture du Canada, 1977, 100 p., https://publications.gc.ca/collections/collection_2014/aac-aafc/agrhist/A73-1362-1977-fra.pdf.
TRUDEL, François, « Autochtones et traite des fourrures
dans la péninsule du Québec-Labrador », Le Nord, coll. « Atlas historique
du Québec », Québec, Les Presses de l'Université Laval, 2001, https://depot.erudit.org/dspace/bitstream/005870dd/1/autochtones-et-traite-des-fourrures-dans-la-peninsule-du-quebec-labrador.pdf.
« Comment les Albertains s'habillaient-ils l'hiver il y
a 100 ans? », Radio-Canada, 18 janvier 2020, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1476468/vetements-alberta-1900-vague-froid-extreme.
« Accessoires en fourrure recyclée », Ecogriffe, 2023,
https://ecogriffe.com/collections/accessoires-en-fourrure-recyclee?srsltid=AfmBOoq9Q-vYBo2dSiQmCg40Rbsb3LHeDQqY_1SlLIeRjQxe-PAI4UbB.
« Coussins », Hélénou Tricot & Fourrure, 2023,
https://helenou.com/collections/coussin-en-fourrure-recyclee?srsltid=AfmBOorqIQCg3e1XhZGrUBsl_9JZU0A5V6EG3Q1o3aclfNcaBoOwHVfs.
« Fin de 200 ans de tradition? », Radio-Canada, 2
septembre 2008, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/409664/buckingham-chapeaux.
« Recyclé », Fourrure Deliska, 2025, https://fourruredeliska.com/boutique/index.php?route=product/search&description=1&search=recycl%C3%A9é